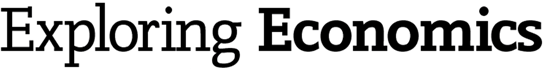Économie évolutionniste
Les perspectives de l'économie pluraliste
Explorer les perspectives Comparer les perspectives
Ce texte présente la pluralité des approches en économie. Dans la section d'orientation, vous pouvez découvrir et comparer dix principales écoles de pensée.
Auteur original: Jan Meyerhoff | 18 décembre 2016
Supervision et révision académique : Dr. Tom Brökel
Traduction française : Tiphaine Rouault
1. Éléments fondamentaux
L’économie évolutionniste analyse comment et pourquoi l’économie évolue. L’accent qu’elle met sur la nature changeante du capitalisme est une caractéristique déterminante qui la différencie des théories économiques non-évolutionnistes. Des sujets qu’elle privilégie parmi d‘autres sont donc la croissance économique, le changement structurel, les processus et systèmes d’innovation, le changement technologique, le changement institutionnel ou encore le développement économique. Ces sujets ne sont toutefois pas spécifiques à l’économie évolutionniste : le modèle néoclassique et les modèles «dominants» de l’économie, par exemple, peuvent également contenir des éléments dynamiques, comme des formes de dépendance au chemin emprunté. Les défenseurs de l’économie évolutionniste analysent néanmoins ces phénomènes sous un angle différent.
Eike W. Schamp (2012, 121) explique que le but des économistes évolutionnistes n’est pas de réaliser une historiographie de l’évolution économique au cas par cas, mais plutôt d’en rechercher des principes généraux. Selon Carsten Herrmann-Pillath (2002, 204), une théorie de l’évolution économique devrait être capable d’expliquer tout aussi bien le changement (par exemple l’innovation) que la stabilité (par exemple les processus de lock-in). Il faut noter par ailleurs que le domaine de l’économie évolutionniste lui-même est constitué de nombreuses approches différentes qui varient en particulier en fonction de leur interprétation du terme « évolutionniste ». En 1987, Ulrich Witt a néanmoins suggéré que les éléments fondateurs de l’économie évolutionniste étaient les suivants :
-
L’attention est portée en premier lieu sur les dynamiques économiques. Cependant, les dynamiques ne sont pas définies comme les mouvements entre les états d’équilibre causées par des circonstances extérieures. Ce sont en fait des processus continus dans lesquels les nouvelles conditions sont générées dans et par le système économique.
-
Un autre élément est le concept de ‘cours du temps historique irréversible’. Cela signifie que le développement économique est également influencé par des développements passés allant dans une direction donnée (dépendance au sentier). Ceci ne signifie pas que les événements historiques sont considérés comme des facteurs déterminants.
-
Un dernier élément est l’importance donnée à l’analyse de l’innovation et de la diffusion.
2. Terminologie, analyse et conception de l’économie
En ce qui concerne la conception de l’économie, il y a un certain nombre d’approches différentes parmi l’économie évolutionniste. Leurs principaux termes et concepts seront présentés dans les paragraphes suivants. Dopfer (2007) a développé un cadre théorique dans lequel il distingue des niveaux micro, meso et macro de l’économie qui seront repris comme principe d’organisation pour cette section. La perspective micro-meso-macro est seulement un des angles d’analyse possible des économie évolutionniste. Carsten Hermann-Pillath (2002), par exemple, insiste sur la structure de réseau du système économique.
Niveau microéconomique
Une différence majeure par rapport à l’économie néo-classique est la conception de la microéconomie. Selon Dopfer (2007), l’économie évolutionniste traite principalement la croissance et la coordination des connaissances économiques nécessaires. Les connaissances sont définies comme des habitudes ou une combinaison d’habitudes (Hermann-Pillath, 2002). Nelson et Winter (1982) ont été les premiers à utiliser la notion d’ « habitudes », tandis que Dopfer (2007) utilisait le terme « règles » pour un concept similaire. Les habitudes sont des règles de prise de décision qui sont répétées régulièrement et représentent une attitude acquise et usuelle pour l’acteur. Selon Dopfer (2007), ce genre de règles et d’habitudes sont constituées de phénomènes aussi divers que les technologies et les institutions sociales. De plus, une distinction peut être faite entre des habitudes dynamiques et statiques. Les habitudes dynamiques englobent par exemple les règles de design de nouveaux produits ou la structure organisationnelle formelle. Les habitudes statiques, en revanche, permettent la répétition d’activités passées et représentent les activités quotidiennes d’une organisation ou d’un acteur. Les connaissances sont considérées comme intégrées dans les opérateurs, c’est-à-dire les entités représentant ces habitudes (individus, organisations, entreprises, etc.) et les réseaux. Elles déterminent en tant que telle l’attitude de ces opérateurs et leur permettent de mener certaines actions, comme la production et les transactions du marché. Les thèmes principaux de l’analyse évolutionniste sont la création, l’adoption, la rétention et la coordination de règles considérées comme malléables, par apposition à l’économie néoclassique.
Niveau méso
L’adoption d’une routine au sein de la population est la plupart du temps analysée au niveau méso. Dans les théories évolutionnistes, on suppose souvent que pluieurs acteurs forment une population. Les caractéristiques des acteurs varient ensuite dans et entre les populations. Selon l’objet de la recherche, ce sont les intervenants du marché, les industries ou les régions d’un pays qui sont percus en tant que populations.
Le darwinisme, pour expliquer le changement économique, offre un concept explicatif évolutionniste spécifique supposant que le changement est du à des mécanismes de variation, de sélection et de rétention (VSR). La supposition principale du paradigme VSR ainsi défini est que la population est constituée d’acteurs hétérogènes. Ces acteurs sont différents les uns des autres au niveau de leurs routines (variété) qui peuvent elles aussi changer dansl le temps (par exemple par l’apprentissage et l’innovation). Ces routines sont sujettes à des pressions sélectives, ce qui aboutit à un foisonnement des routines ayant un succès reproductif plus important dans la population. Le principal critère de sélection est généralement la mesure dans laquelle une routine facilite l’usage efficient des ressources essentielles à la reproduction.
Par conséquent, comme dans l'économie néoclassique, la rareté joue un rôle central, puisque l'on suppose que la concurrence pour des ressources rares conduit à une pression sélective. Ainsi, des routines mieux adaptées seront reproduites plus souvent. Par conséquent, les routines qui permettent des produits ou des méthodes de production plus efficaces que les routines concurrentes sont plus susceptibles de s'imposer sur le marché (Hermann-Pillath, 2002, 34). Le résultat de ce processus peut être compris comme une adaptation à l'environnement sélectif (Hermann-Pillath, 2002, 206).
Un autre concept évolutionniste crucial est la dépendance au sentier. Les défenseurs de ce concept mettent l’accent sur le fait que le point de départ d’un développement (les événements passés, ainsi que leur ordre historique spécifique et leur simultanéité) a un impact important sur le résultat final des activités économiques (David, 1984, dans Garud & Karnoe, 2001, 4). Ainsi, les développements actuels ne sont jamais libres de leur histoire (Hermann-Pillath, 2002, 232).
Niveau macro
Le niveau macro est constitué d’un nombre important de règles et de plusieurs populations. Il n’est en tant que tel pas une simple aggrégation du niveau micro mais plutôt défini par l’auto-organisation des populations et des structures du niveau méso. Ceci signifie que des processus au niveau macro peuvent uniquement être expliqués grâce au niveau méso, soit l’analyse des populations à la place de celle des acteurs (Dopfer and Potts, 2007).
En résumé, le changement est majoritairement expliqué au niveau méso et peut être intégré ou limité par des structures au niveau micro et macro (Dopfer et. al., 2004).
Il y a encore tant à découvrir !
Dans la section Découvrir, nous avons rassemblé des centaines de vidéos, de textes et de podcasts portant sur des problèmes économiques. Vous pouvez aussi nous proposer du contenu vous-même !
Découvrir du contenu Proposer du contenu
3. Ontologie
Là où l’économie dominante traite de l’utilisation optimale des ressources rares pour satisfaire les besoins personnels, il est suggéré dans l’économie évolutionniste que c’est le savoir qui est le phénomène central. C’est pourquoi l’incertitude et l’ignorance totale, soit l’absence de savoir, sont considérées comme les problèmes économiques principaux (Herrmann-Pillath 2002, 22). Ceci signifie que le fondement ontologique de l’économie évolutionniste se différencie radicalement de celui de l’économie dominante. La perspective évolutionniste considère les connaissances aussi bien que les individus comme étant des phénomènes réels (existant ontologiquement). Herrmann-Pillath (2002, 33) définit ceci en tant qu’ontologie bimodale. D’un point de vue méthodologique, l’économie évolutionniste considère que l’interaction entre les individus provoque la formation de nouvelles entités dont les caractéristiques ne peuvent pas être réduites au niveau individuel. Ce postulat est également connu sous le terme d’émergentisme. À propos du rôle des conaissances dans un tel système ontologique, Hermann-Pillath observe que “la prémisse ontologique fondamentale de l’économie évolutionniste est que dans les systèmes complexes de partage de savoir, seules les connaissances individuellement et subjectivement disponibles sont pertinentes en pratique, tandis qu’au niveau du système dans son ensemble, la performance est déterminée par le niveau général effectif de connaissances. Ainsi, ce dernier possède un statut ontologique propre en tant que cause indépendante de phénomènes économiques.” (Hermann-Pillath 2002, 33).
Sur le plan méthodologique, l'économie évolutionniste suppose que l'interaction des individus conduit à la formation de nouvelles entités, dont les caractéristiques ne peuvent être réduites au niveau individuel. Ce postulat est également connu sous le nom d'émergentisme. En ce qui concerne le rôle du savoir dans un tel système ontologique, Hermann-Pillath observe que "la prémisse ontologique fondamentale de l'économie évolutionniste est que, dans les systèmes complexes de partage du savoir, seul le savoir disponible individuellement et subjectivement est pertinent en pratique, tandis que la performance du système dans son ensemble est déterminée par le niveau global de la connaissance effective. Ce dernier a donc son propre statut ontologique en tant que cause indépendante de phénomènes économiques" (Hermann-Pillath 2002, 33).
Par conséquent, l’analyse se concentre sur des sujets économiques qui font seulement preuve d’une “rationalité limitée” plutôt sur des acteurs rationnels et cherchant à maximiser leur utilité. Ces sujets économiques ne sont capables ni de discerner toutes les actions possibles, ni d’évaluer leurs coûts et leur utilité, et ne sont ainsi pas en mesure de calculer une facon optimale de procéder. Il est suggéré à la place que les décisions des sujets économiques sont basées sur l’heuristique. Lorsque l’on retient une prise de décision basée sur l’heuritique, il n’y a pas de solution optimale, mais les solutions sont examinées jusqu’à ce qu’une possibilité soit trouvée qui satisfait l’objectif visé ou qui permet le dépassement d’une certaine limite pour atteindre un but (“niveau d’ambition”). Herbert Simon (1957) a inventé le terme “satisficing” pour décrire ce comportement.
Cependant, le concept de rationalité limitée - tout comme le concept néoclassique du comportement et ses hypothèses d’optimisation - ne parvient pas à justifier l’idée de création de nouvelles opportunités (Witt, 2001). Le concept de rationalité limitée explique seulement comment les décisions sont prises sur la base d’un ensemble d’alternatives clairement définies. En économie néoclassique, ce modèle de prise de décision est considéré comme parfait, tandis qu’en économie évolutionniste, il est considéré comme imparfait. Le but de l’économie évolutionniste est donc de dépasser l’idée d’un processus de prise de décision adaptatif et de concevoir un modèle cognitif créatif afin de vraiment rendre compte de l’action innovative (Röpke, 1977). Joseph Schumpeter, considéré comme l’un des pères fondateurs de l’économie évolutionniste, considérait le processus d’innovation comme le principal moteur du développement économique. Il concevait les innovations comme de nouvelle combinaisons du savoir disponible. Witt (2001) souligne que les humains ont la capacité d’imaginer des situations qui n’existent pas encore. Ils créent ainsi de nouvelles possiblités d’action, les testent et les mettent en oeuvre (Witt 2001)
4. Épistémologie
Le postulat de l’ignorance fondamentale signifie que les connaissances peuvent toujours s’avérer érronées. Ainsi, chaque déclaration sur le monde est hypothétique. Cet axiome est associé à l‘épistémologie évolutionniste du réalisme hypothétique. Par conséquent, toutes les connaissances ne naissent a priori pas au niveau des individus. De même, les acteurs n’ont pas accès à toutes les connaissances mais perçoivent différents élément des connaissances générales, raison pour laquelle l’individualisme méthodologique ne peut pas fournir une explication suffisante du système. Les connaissances peuvent paraîtrent subjectives ou comme un phénonmène éméergent des interactions entre les acteurs du réseau. Les connaissances générales est ainsi plus importante que la somme des connaissances individuelles subjectives. L'épistémologie évolutionniste met l’accent sur l’apparation et la diffusion des connaissances plutôt que de traiter la question de la véracité des connaissances. Selon cette épistémologie, qui est principalement défendue par Konrad Lorenz, Donald T. Campbell, Gerhard Vollmer et Rupert Riedl, il y a au moins une réalité indépendante de l’être humain. Cette réalité possède une structure composée de relations causales existantes qui sont reconnaissables, au moins en partie.
5. Méthodologie
Contrairement à l’approche statique comparative de l’économie néoclassique, l’économie évolutionniste traite des dynamiques de l’économie dans le temps historique. L’économie évolutionniste fait des recherches à la fois déductives et inductives (Boschma and Frenken, 2006, 291). Elles ne cherchent pourtant pas toujous la généralisation. Au contraire, on reconnaît que les connaissances peuvent être limitées à un contexte spécifique dans l’espace et le temps.
De plus, l’économoie évolutionniste n’est ni exclusivement basée sur l’individualisme méhodologique (réductionnisme), ni sur le collectivisme méthodologique. Il y a, à la place des mécanismes de sélection tant au niveau des routines et des individus qu‘au niveau des entités de niveau supérieur (Bowles, 2004, 479). De plus, des modèles formalisés et des méthodes empiriques quantitatives sont tout aussi bien utilisées que des méthodes qualitatives. L’économoie évolutionniste est en soi très interdisciplinaire puisqu’elle n’applique pas seulement des concepts et des termes (p. Ex. Issus de la biologie) mais aussi des méthodes d’autres disciplines (p. Ex. L’analyse des réseaux sociaux – ARS).
Outre les techniques de régression largement utilisées, l’économie évolutionniste utilise l’analyse des réseaux sociaux pour examiner l’évoution des réseaux; la modélisation en mode agent et informatique; et la théorie évolutive des jeux. Cet ensemble de méthodes est complétée par des enquêtes et des méthodes qualitatives, telles que des interviews. L’économie évolutionniste embrasse donc l’ambition d’une méthodologie pluraliste, en accord avec le “anything goes” de Feyerabend. Ainsi, les méthodes qui se prêtent à l’analyse des développements et des dynamiques sont les plus utilisées.
6. Idéologie et buts politiques
L’interprétation positive de l’innovation et du changement peut être considérée comme un aspect idéologique de l’économie évolutionniste. Ainsi, l’économie innovative et adaptable peut être interprétée comme un point de repère normatif puisque le développement économique positif est imputable à la capacité à innover et à s’adapter à un environnement technique et économique changeant. Par conséquence, une grande importance est accordée aux politiques touchant à la recherche, l’innovation et la technologie. On peut considérer idéologique le fait que l’innovation soit perçue comme un principe directeur et que les facteurs déterminant l’innovation, eux-mêmes dérivées des théories économiques évolutionnistes, soit utilisés comme base pour le conseil politique. D’un autre côté, l’idéal néoclassique de marchés à l’efficience au sens de Pareto a tendance à être rejeté. Les théories évolutionnistes ne suggèrent pas que le bien-être global est maximisé par des marchés parfaits avec une compétition parfaite ou que la stratégie politique économique devrait aspirer à la création de ce genre de marchés compétitifs.
Par conséquence, la politique économique ne devrait pas seulement aborder le marché, mais plutôt “se reporter à la totalité et à la complexité des réseaux et de leurs dimensions dans lesquelles les processus qu’elle a l’objetif d’influencer sont incorporés” (traduction de Hermann-Pillath, 2002, p.441, propre traduction). Les défenseurs de l’approche du système d’innovation argumentent par exemple que, tout comme la défaillance du marché, une défaillance du système d’innovation national (“défaillance du système”) pourrait survenir, mais que cette défaillance pourrait être éviter par l’état et justifie ainsi des politiques d’intervention. Il n’y a toutefois pas d’accord sur l’organisation d’une économie adaptive et innovative, c’est-à-dire sur les moyens d’éviter une défaillance du système innovatif. Puisqu’aucun acteur politique n’a de connaissances parfaites, les interventions politiques peuvent également échouer. Outre la capacité cognitive limitée des acteurs, les problèmes à résoudre sont très complexes. Ainsi, des processus de prises de décision rationnels ou déductifs ont tendance à être rejetés. A la place, ce sont des processus inductifs basés sur des expérimentations qui sont adoptés. Dans ce contexte, l’importance des expériences passées et des connaissances disponibles pour la prise de décisions est accentuée (Metcalfe, 1994).
La théorie évolutionniste a par exemple trouvé le moyen de se faire entendre dans les politiques régionales de l’Union Européenne, qui visent entre autres à augmenter les activités de recherche et développement (R&D) dans les régions européennes. Un exemple est la stratégie appelée “spécialisation intelligente” qui a pour but de faire de l’Europe une zone économique innovative. Bien que cette stratégie ait été estampillée de spécialisation intelligente, il s’agit en réalité de diversification. La nouveauté de cette stratégie est que les décisions de diversification devraient être étroitement liées aux connaissances disponibles dans la région, par exemple que de nouveaux secteurs économiques soient “liés” aux anciens, car cela favorise le transfert de connaissances et augmente la possibilité d’une diversification et d’une innovation réussies. De plus, la décision concernant de nouvelles diversifications devraient venir du discours social (“découverte entrepreunariale”) qui contient les parties prenantes adéquates (Boschma and Gianielle, 2014).
7. Débats et analyses actuels
Un des débats centraux est le fait de savoir si le darwinisme peut être appliqué à l’évolution économique en tant que phénomène social. Les hypothèses universelles de variation, sélection et de patrimoine du darwinisme ne sont généralement reconnues au sein de la communauté des économistes évolutionnistes. Les opposants affirment notamment qu’il manque un mécanisme qui puissent être considéré comme héréditaire à l’évolution du système économique. L’évolution économique suivrait plutôt ses propres règles, puisqu’une partie de l’évolution culturelle est sujette à des évolutions beaucoup plus rapides. C’est ce qu’on appelle l’hypothèse de continuité. De plus, l’apparition d’innovations dans la sphère socio-économique n’est pas seulement une pure coïncidence comme c’est le cas en génétique.
8. Délimitation : écoles de pensées similaires, autres théories économiques et autres disciplines
Une délimitation claire des différentes écoles de pensées similaires est difficile, mais des éléments spécifiques aux différentes théories peuvent être identifiés. Certaines approches renvoyent plus ou moins à des termes et concepts de biologie évolutive, tandis que d’autres se concentrent sur les concepts de dépendance au sentier, d’auto-organisation de systèmes complexes ou de changement institutionnel et culturel.
Le darwinisme universel conçoit l’évolution économique comme un changement dirigé qui nait de la formation, la sélection et la conservation de nouvelles habitudes (connaissances). Ce changement a besoin de diversité, mais le changement lui-même crée de la diversité. Selon Essletzbichler (2012, 129), le darwinisme universel est un cadre théorique pour comprendre l’évolution de systèmes de populations complexes. Les populations d’entités hétérogènes évoluent en interagissant entre elles et avec leur environnement qu’elles façonnent ainsi. Le darwinisme universel s’inspire de la génétique et contient “l’hérédité d’instructions réplicatives d’entités individuelles, une variation de réplicateurs et d’interacteurs et un processus de sélection des interacteurs dans une population” (traduction de Hodgson/Knudsen, 2010, 65, in Essletzbichler, 2012).
La variation est créée par la transformation endogène et l’apparition de nouvelles charactéristiques, causées par le hasard et la recherche volontaire d’acteurs cherchant à innover. Le terme biologique phénotype correspond au terme “interacteur” dans l’économie évolutionniste. Essletzbichler (2012, 133) définit un interacteur en tant qu’”entité qui interagit directement avec son environnement en tant que tout cohérent”. Pour chaque interacteur, il y a tout un éventail de réplicateurs. Le terme “réplicateur” correspond au terme biologique “génotype”. Les réplicateurs sont certaines charactéristiques des interacteurs (principalement leurs habitudes), considérés comme leurs gênes. Des individus, des organisations mais aussi des pays et des régions peuvent être des interacteurs. Ils sont considérés comme les “vecteurs” des réplications (par exemple les habitudes). L’infomation sur l’adaptation réussie des interacteurs (phénotypes) est transmise par les réplicateurs (génotypes) au cours du temps. Ces derniers entravent l’adaption immédiate aux changemetns de l’environnement. Différentes sortes de variations sont donc garanties, condition nécessaire pour qu’une sélection ait lieu. La sélection aboutit à un taux de survie plus élevé pour des interacteurs qui sont mieux adaptés dans un contexte local spécifique et historique. Ceci signifie que les phénotypes transmettent leurs génotypes à un taux plus élevé (Essletzbichler, 2012, 130).
Pour les néo-schumpeteriens, le concept de sélection est l’élément central de l’économie évolutionniste. Ceci inclut l’approche de Nelson et Winter dans “Une théorie évolutionniste du changement économique” (Cordes, 2014, 2; Nelson et Winter, 1982). Ils ont importé les concepts biologiques en économie d’une manière plutôt métaphorique, alors que Metcalfe (1994) applique directement un modèle de sélection naturelle à la compétition économique. L’approche des systèmes d’innovation (Lundvall, 2010) fait notamment partie de la tradition neo-schumpéterienne.
Les concepts naturalistes au sein de l’économie évolutionniste supposent que l’hérédité biologique des êtres humains a un impact durable sur leur comportement actuel et que ceci limite l’évolution économique (Cordes, 2014, 5). Selon Cordes (2014,5), La théorie de Thorstein Veblen (1898) sur le changement institutionnel apparteint à ce courant de pensée (alors qu’il est généralement considéré comme un institutionnaliste américain). Ce genre de changement institutionnel est également examiné par Friedrich von Hayek et Douglas North. Le domaine de la “bio-économie” définie par Nicholas Georgescu-Roegen pourrait également être classé ici. Cette dernière met en avant les limites à long terme de l’évolution économique causées par l’évolution biologique (Cordes, 2014, 8).
Les théories de dépendance au sentier ne font pas forcément référence aux termes et concepts biologiques. Les adeptes de cette approche mettent en avant l’importance de la genèse d’un phénomène afin de comprendre son développement futur et ses caractéristiques actuelles. Garud et Karnoe (2001) ont complété ce concept de dépendance au sentier avec celui de “création de sentier”. La notion de création de sentier se rapporte aux mécanismes selon lesquels de nouveaux sentiers économiques et technologiques apparaissent et prennent plus de place.
Les théories de la complexité sont également associées à l’économie évolutionniste jusqu’à un certain point. Cela inclut en particulier les approches de l’économie de la complexité qui sont nées de la coopération interdisciplinaire développée notamment par des physiciens, des biologistes et des économistes à l’Institut Sante Fe, Nouveau-Mexique (Etats-Unis). Cette coopération a été initiée par Kenneth Arrow. Ses représentants actuels sont Brian Arthur ou encore Samuel Bowles. L’economie de la complexité emploie des concepts comme la dynamique, les systèmes ouverts, l’auto-organisation et la causalité cumulative de processus socio-économiques (retours positifs). De plus, les dépendances au sentier et les processus de sélection jouent souvent un rôle important. Le phénomène de la complexité est décrit séparement en tant que propre perspective sur cette page internet (lien).
Restez à l'écoute !
Inscrivez-vous à notre newsletter pour connaître les nouveaux défis, conférences et ateliers d'écriture.
Abonne-toi à la newsletter
9. Délimitation par rapport au courant dominant
La position de l’économie évolutionniste au sein des sciences économiques est controversée. Certains adeptes la considèrent comme une discipline secondaire qui concerne l’'innovation, l’entrepreunariat et le changement technologique. Dans cette définition relativement restrictive, les postulats néoclassiques ou traditionnels ne sont pas forcément rejetés. Ainsi, l’économie évolutionniste est considérée comme une discipline secondaire comme une autre, telle que l’éconmie environnementale. D’autres la voient come une approche fondamentalement différente de recherche sur l’économie (voir Herrmann-Pillath 2002: 21-22).
10. Institutions
Institutions scientifiques :
-
European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE)
-
Internationale Joseph A. Schumpeter Gesellschaft (ISS)
-
Association for Evolutionary Economics (AFEE)
Journaux importants:
-
Journal of Evolutionary Economics
-
Research Policy
-
Industrial and Corporate Change
-
Journal of Institutional Economics
-
Journal of Economic Issues
-
Journal of Economic Geography
Liens:
-
Papers on Economics and Evolution, Max-Planck-Institut für Ökonomik: http://www.econ.mpg.de/deutsch/research/EVO/discuss.php
-
Evonomics (Blog): http://evonomics.com/
Références
Boschma, R., Frenken, K. (2006). Why is economic geography not an evolutionary science? Towards an evolutionary economic geography. Journal of Economic Geography, 6, 273–302.
Boschma, R., & Gianelle, C. (2014). Regional branching and smart specialization policy. JRC technical reports, (06/2104).
Bowles, S. (2009). Microeconomics: behavior, institutions, and evolution. Princeton University Press.
Cordes, C. The Application of Evolutionary Concepts in Evolutionary Economics. Papers on Economics & Evolution. Max Planck-Institut für Ökonomik. Nr. 1402.
David, P. A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. The American economic review, 75(2), 332-337.
Dopfer, K. (2007): Grundzüge der Evolutionsökonomie - Analytik, Ontologie und theoretische Schlüsselkonzepte. Discussion Paper Universität St. Gallen.
Dopfer, K., Foster, J., & Potts, J. (2004). Micro-meso-macro. Journal of Evolutionary Economics, 14(3), 263-279.
Dopfer, K., Potts, J. (2007): The General Theory of Economic Evolution. Routledge.
Essletzbichler, J. (2012). Generalized Darwinism, group selection and evolutionary economic geography. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 56 (3): S. 129 – 146.
Feyerabend, P. K., & Vetter, H. (1976). Wider den Methodenzwang: Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Lundvall, B. Å. (Ed.). (2010). National systems of innovation: Toward a theory of innovation and interactive learning (Vol. 2). Anthem Press.
Garud, R., & Karnoe, P., (2001). Path Creation as a Process of Mindful Deviation: Dependence and Creation. London: Lawrence Erlbaum Associates, 1-38.
Herrmann-Pillath, Carsten 2002: Grundriß der Evolutionsökonomik, Wilhelm Fink Verlag: München
Hodgson, G. M., & Knudsen, T. (2010). Generative replication and the evolution of complexity. Journal of Economic Behavior & Organization, 75(1), 12-24.
Metcalfe, J. S. (1994). Evolutionary economics and technology policy. The economic journal, 104(425), 931-944.
Nelson, R. R., & Winter, S. G., (1977). In Search of Useful Theory of Innovation. Research Policy, 6 (1), 36-76.
Schamp, E. W. (2012). Evolutionäre Wirtschaftsgeographie. Eine kurze Einführung in den Diskussionsstand. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 56 (1-2), 121-128
Simon, H. A. (1957). Administrative theory: A study of decision-making processes in administrative organization. New York: Macmillan.
Witt, U. (2001). Learning to consume–A theory of wants and the growth of demand. Journal of Evolutionary Economics, 11(1), 23-36
Witt, U. (1987). Individualistische Grundlagen der evolutorischen Ökonomik (Vol. 47). Mohr Siebeck.
Modules de cours assignés
| Titre | Intervenant | Institution | Date de début | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Emergence Theory | Think Academy | - | rythme libre | débutant |
| Capitalism: Competition, Conflict, Crisis | Anwar Shaikh | The New School | flexible | avancé |
| State, Law and the Economy | Prof. Y.C. Richard Wong | n.a. | 24.03.2020 | avancé |
| An Introduction to Political Economy and Economics | Dr Tim Thornton | n.a. | 2022-01-30 | débutant |
| Eine Einführung in Agentenbasierte Modellierung mit Python | Dr. Claudius Gräbner | n.a. | toujours | avancé |
| Water Resource Management and Policy | Prof. Geraldine Pflieger, Dr. Christian Brethaut | Graduate Institute of International and Development Studies Geneva | rythme libre | avancé |
| Makroökonomische Modelle - Ein multiparadigmatischer Überblick | Claudius Gräbner | University of Duisburg-Essen | toujours | avancé |
Organisations et liens
The Association for Evolutionary Economics
http://afee.net/
European Association for Evolutionary Political Economy
http://eaepe.org/
Littérature
The General Theory of Economic Evolution
Année de publication: 2007
Routledge
Grundriß der Evolutionsökonomik
Année de publication: 2002
Wilhelm Fink Verlag
Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics
Année de publication: 1994
Edward Elgar Publishing
Les Théories Économiques Évolutionnistes
Année de publication: 2010
La Découverte
Leçons de Microéconomie Évolutionniste
Année de publication: 2012
Odile Jacob
Un réexamen de l’économie « évolutionniste » de Thorstein Veblen
Année de publication: 2004
Thèse soutenue à l’Université Lumière Lyon 2